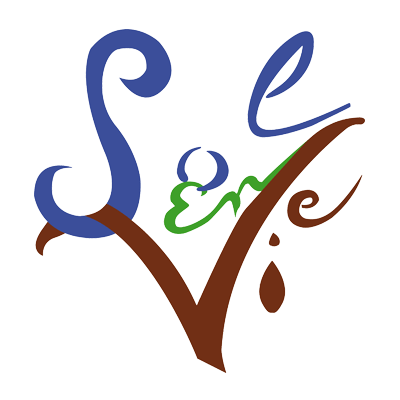Le sol est constitué de minéraux et de matière organique. Celle-ci provient des feuilles, des racines, et des composés sécrétés par les plantes dans la terre. Des bactéries, des champignons du sol et d’autres petits êtres vivants s’en nourrissent et la transforment. Elle est constituée d’un mélange de diverses molécules organiques (à base de carbone C et d’oxygène O). Elle rend le sol fertile, et lui permet de garder l’humidité.
Les champs suisses perdent la matière organique du sol depuis des dizaines d’années. Si cette tendance se poursuit, la production alimentaire pourrait être compromise. Elle doit donc être jugulée ou inversée. D’autre part, le carbone perdu est rejeté dans l’atmosphère sous forme de CO2 et augmente l’effet de serre. Le sol en contient une énorme quantité, dont l’oxydation pourrait aggraver dangereusement le réchauffement climatique. Au contraire, une augmentation du carbone du sol de 4 pour 1000 par an absorberait nos émissions de carbone d’une façon inoffensive et bénéfique (initiative 4p1000 https://www.4p1000.org/fr).
Lire la suite de l’article sur :
https://blogs.letemps.ch/dorota-retelska/2021/02/21/leffet-de-serre-peut-devenir-humus-fertile/