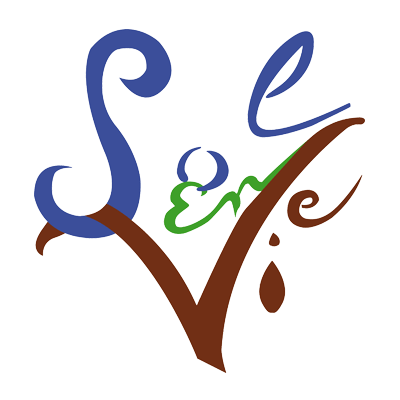Depuis le temps qu’on vous le dit… ce n’est pas nous qui allons dire le contraire !
Face à des problèmes de rendement ou pour réajuster son système de production avec une meilleure complémentarité sol-plante-animal, réaliser un profil de sol peut s’avérer particulièrement intéressant. Il donne davantage de clefs sur le fonctionnement du sol qu’une simple analyse de sol.
Lire l’article sur :
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/ameliorer-ses-rendements-avec-la-realisation-d-un-profil-de-sol-217-204503.html