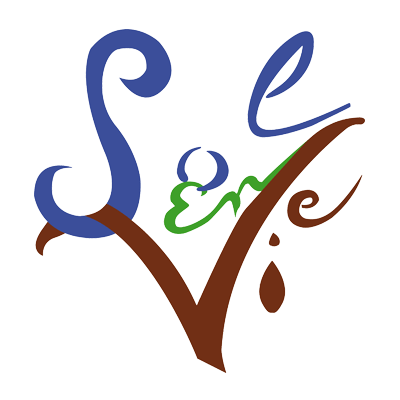Vers une gestion territoriale des sols
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis son origine, l’Académie d’Agriculture a porté une attention particulière au sol, fondement de la production agricole. La FAO (2015) a souligné que l’augmentation projetée de la production agricole serait de 60 % pour répondre aux besoins mondiaux, et rappelé que cette production est assurée pour 95 % par les sols. Un groupe de travail, lancé à la faveur de l’année internationale des sols de 2015, a réuni des membres de cinq sections sur dix pendant plus de trois ans, pour préparer plusieurs séances et colloques, un dossier « Le sol : un patrimoine à valoriser » (Rev. Acad. Agri., 2015), une série de six ouvrages « Les sols au cœur de la zone critique » (2018) en versions française et anglaise (ISTE, Wiley), destinés à l’enseignement supérieur, et contribuer à un numéro sur les sols des Annales des Mines(2018). En situant les sols au cœur des échanges d’eau, de matière et d’énergie, le concept de zone critique qui s’étend des roches à la basse atmosphère a en effet considérablement renouvelé l’étude des sols dans une perspective résolument interdisciplinaire, associant aux enjeux de production agricole et des enjeux de régulation de la qualité des milieux (eau, air, biodiversité).
Bien que négligés pendant plusieurs décennies, les sols retrouvent un intérêt auprès des pouvoirs publics français, comme en attestent le rapport du Conseil Economique Social et Environnemental de 2015 « La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société » et le lancement fin 2016 du réseau national d’expertise sur les sols (RNEST) à l’instigation des ministères en charge de l’agriculture, de la transition écologique et de la recherche. En témoignent également la prospective de l’ANR sur les sols agricoles (2015) et le livre blanc du CNRS sur les sols (2015). Les sols reviennent également sur l’agenda international, comme l’ont souligné le lancement par la FAO en 2012 du Partenariat Mondial sur les Sols et plus récemment de son Groupe technique intergouvernemental sur les sols (ITPS), et par les Nations Unies de l’Année Internationale sur les sols en 2015. En témoignent également le rapport « Sustainability of Europe’s soils » (2016) et l’Atlas mondial de la désertification (2018). De fait, les sols se situent à la confluence des trois conventions de RIO. Celle sur la lutte contre la désertification porte sur la dégradation des sols. L’IPBES, groupe d’experts de la convention sur la diversité biologique a remis son rapport sur la dégradation et la restauration des terres. Le sixième rapport du GIEC comprendra un volet spécialement dédié aux terres émergées.
Les sols doivent répondre à de nombreux enjeux : sécurité alimentaire ; atténuation du réchauffement climatique (initiative 4 pour mille) ; maintenir la diversité des communautés d’organismes ainsi que la très large variété des fonctions assurées; réguler les cycles hydrologiques et biogéochimiques (C, N, P, S, etc.) ; faire face à l’étalement urbain, l’artificialisation et l’imperméabilisation ; contribuer à la production d’agrocarburants, et de matériaux divers de construction et de molécules biosourcées pour l’industrie ; servir de sites de dépôts et de gestion de déchets ; contrôler la qualité des eaux ; assurer des fonctions socio-culturelles et contribuer aux activités liées à la qualité de l’habitat et des loisirs … De très nombreux conflits trouvent leur origine dans cette diversité des usages des sols, et de leurs statuts juridiques et réglementaires (code rural, code de l’environnement, code de l’urbanisme, code forestier, code minier, code de santé publique, protection de la biodiversité ou d’espèces menacées…). Ces conflits rendent nécessaire la définition et la mise en œuvre d’une gouvernance territoriale des sols. L’utilisation actuelle des sols agricoles, fondée surtout sur les droits de propriété foncière, de l’urbanisme et de l’environnement, tient de fait très peu compte des services multiples qu’ils peuvent fournir localement et globalement aux populations. Cette gouvernance ne pourra correctement s’exercer que si les différentes parties prenantes ne se bornent pas à défendre leurs intérêts propres ou leurs convictions militantes, d’autant que le public demeure très mal informé de ce que sont les sols et leurs fonctions. Toutes les parties prenantes devraient pouvoir se fonder sur des données scientifiques bien établies, mais aussi sur des analyses économiques et d’aménagement de l’ensemble du territoire (villes et campagnes), d’où l’importance de la mise en place et du financement des dispositifs de suivi de l’état des sols. Ces travaux sur l’état et l’évolution de la qualité des sols doivent s’appuyer sur des compétences solides, grâce à la formation de spécialistes des sols. Or, l’enseignement supérieur de science du sol a fortement souffert de la disparition en 2005 du DEA National de Science du Sol, de la mise en place du système Licence, Maîtrise, Doctorat (LMD) et de l’autonomie des Universités qui ont défavorisé les disciplines pluri- et inter- disciplinaires en les intégrant dans de nouveaux cursus (sciences de l’environnement, géographie, gestion des ressources naturelles, etc.) rendant ainsi le sol très peu visible dans l’offre actuelle de formation.
RECOMMANDATIONS
Gouvernance territoriale des sols
Pour construire des territoires durables, qu’ils soient métropolitains ou ultramarins, les décisions concernant l’usage des sols devraient être prises selon le principe de subsidiarité entre État, régions et territoires qui restent à bien définir pour correspondre à des entités agronomiques et environnementales fonctionnelles et opérationnelles, avec la participation de toutes les parties prenantes en vue d’aboutir à des propositions consensuelles. Ainsi pourraient être élaborés des communs territoriaux dans le cadre institutionnel des collectivités locales, en partageant les droits de propriété et d’usage des sols, grâce à des processus de facilitation et à des médiateurs. Plusieurs expériences menées en France démontrent que la gouvernance territoriale des sols agricoles en tant que communs territoriaux n’est plus une utopie.
À cet effet, il est nécessaire de s’appuyer (i) sur une information correcte, en vue d’établir des modèles et des outils d’aide à la décision qui permettent la construction collective des biens communs, comme ceux de l’alimentation en eau potable, (ii) sur le concept de zone critique qui associent les sols avec l’air, la végétation et les eaux souterraines et de surface, (iii) sur des instances d’arbitrages correctement formées dans le domaine des sols et de la zone critique.
Recherche
Afin de mettre en pratique ces principes de gouvernance, de définir l’affectation des sols et de raisonner les pratiques, il est essentiel de disposer d’informations fiables sur les sols et leur état, fondées sur des dispositifs de suivi à long terme et associées à des recherches sur leur distribution et leur évolution. De tels dispositifs couvrent déjà le territoire national grâce au Groupement d’intérêt scientifique Sols (GIS Sols) qui gère la Base de Données d’Analyses des Terres, le Réseau de mesure de la qualité des sols, et l’Inventaire, Gestion et Conservation des Sols), mais ceux-ci, encore très fragiles financièrement, restent à consolider. Des zones ateliers et des observatoires de l’infrastructure de recherche OZCAR (observatoires de la zone critique, applications et recherches) permettent des suivis et modélisations à long terme des processus à la fois biophysiques et sociaux. Par ailleurs, les progrès récents en métagénomique des sols et les mécanismes d’interactions entre plantes et microorganismes du sol constituent l’un des éléments moteurs de l’agriculture du futur. Les domaines de recherche et les ambitions des dispositifs expérimentaux et des observatoires sont à conforter non seulement pour le progrès des connaissances mais aussi pour mieux faciliter l’accès aux données pour répondre aux demandes des utilisateurs, et diversifier les échelles d’information, de la parcelle aux petits bassins versants, paysages, terroirs ou à la région (aménagement du territoire, périmètres de protection des eaux, définition des appellations, plans d’urbanisme…). Dès lors, il importe aussi de proposer des approches innovantes de diffusion de ces informations sur les sols pour les rendre accessibles et compréhensibles, pour les acteurs directement concernés et, plus largement, pour l’ensemble des citoyens.
Formation
En vue de rendre plus visible les sols dans l’enseignement supérieur, il importe de structurer un master national ou européen dédié aux sols, en tirant parti des spécialisations d’ingénieur et des parcours de masters existants, et de l’expérience des réseaux d’enseignants-chercheurs qui construisent des ambitions européennes sur les sols. Cela passe par le recrutement d’enseignants-chercheurs de l’ensemble des disciplines impliquées dans la connaissance des sols, afin de donner une vision intégrative des sols, de leur diversité spatiale ainsi que de leurs fonctions écologiques, physiques et biogéochimiques. Il s’agit de proposer des approches pluridisciplinaires pour les questions de production agricole, des écosystèmes sols-plantes-atmosphère, d’environnement, d’urbanisme et de changement global.
Il existe également un besoin urgent de développer l’enseignement sur les sols dans les parcours des écoles, des collèges et lycées.