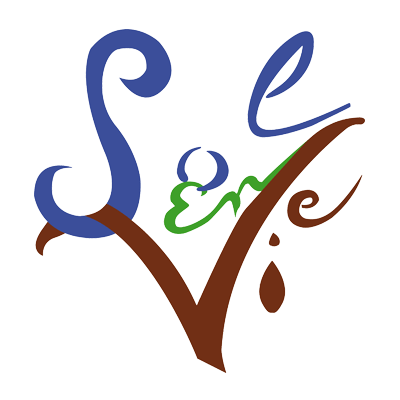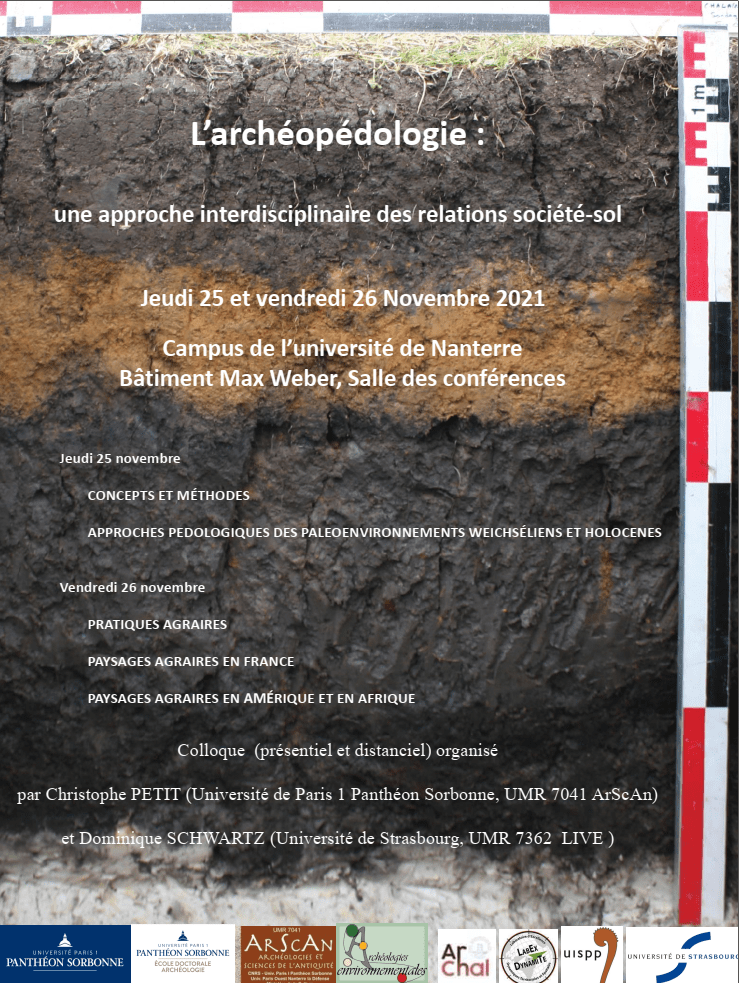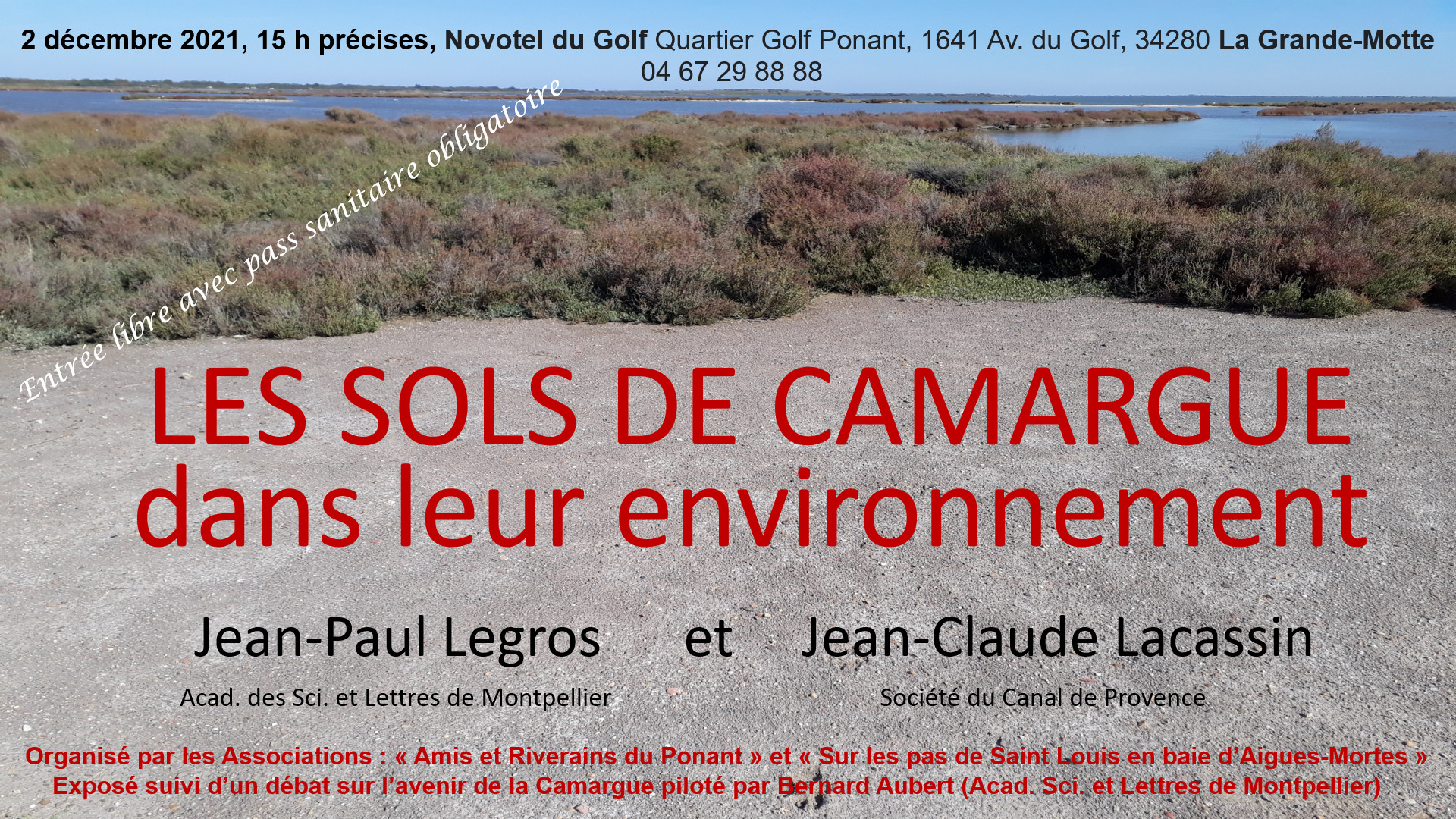|
Le Varenne agricole de l’eau : une opportunité pour une agriculture durable
Le Gouvernement a lancé en mai 2021 le « Varenne de l’eau et du changement climatique ». C’est une réelle opportunité car jusqu’à présent, les réflexions nationales ont surtout porté sur la contribution de l’agriculture à l’atténuation du changement climatique, en réduisant notamment les émissions. Dans le cas du « Varenne », il s’agit de trouver des solutions pour assurer la fonction nourricière de l’agriculture française et de la rendre plus résiliente face au dérèglement climatique. Les propositions d’adaptation doivent mobiliser des compétences pluridisciplinaires pour assurer la performance économique, environnementale et sociétale de l’agriculture.
En effet, l’agriculture est en pleine mutation. Après la Seconde Guerre mondiale, la production était déficitaire et des outils ont été mis en place pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Cette voie a engendré des dérives environnementales. Aujourd’hui, l’agriculture doit aller au-delà de sa fonction nourricière : nourrir en démontrant qu’elle contribue de manière significative aux objectifs de durabilité.
Anticiper le dérèglement climatique
Au niveau mondial, les agriculteurs sont « condamnés » à produire plus pour nourrir un monde de plus en plus peuplé. Et cette nécessité s’inscrit dans un contexte où le rendement de nombreuses espèces cultivées stagne à cause des effets du dérèglement climatique.
En outre, le dérèglement climatique constitue un frein à la mise en œuvre de l’agroécologie. En effet, les pratiques agroécologiques reposent sur la diversification des espèces. Comme pour les espèces qui nous nourrissent, la mise en œuvre de ces pratiques est également fortement soumise aux effets du climat, de plus en plus défavorables, et imprévisibles (sécheresse, excès d’eau, températures excessives, ou au contraire gélives et tardives, rayonnement trop faible…)
Tout va très vite, et il nous faut anticiper : comment la cartographie des espèces va-t-elle évoluer pour identifier par là même les adaptations dans les territoires ?
Accroître la disponibilité en eau
Accroître la disponibilité en eau constitue le levier le plus efficace car elle garantit la stabilité de la production et permet la diversification des espèces. Une solution serait de stocker une partie de l’eau qui tombe en excès pour irriguer sachant que l’eau d’irrigation retourne à l’atmosphère : imaginer en quelque sorte des fermes « eautonomes ». En outre, il est possible de recycler les eaux usées, recyclage qui concerne environ 0,6 % des usages de l’eau en France, contre 8 % en Italie, 14 % en Espagne et 80 % en Israël.
L’agroforesterie qui consiste à faire cohabiter des arbres avec des cultures est une voie à explorer : les racines des arbres descendent en profondeur et jouent le rôle « d’ascenseur hydraulique ». Et aussi, comme l’implantation de couverts permanents qui couvrent le sol, l’agroforesterie exerce un rôle de régulation des inondations.
Poursuivre les recherches en génétique
Sans le progrès génétique, le rendement de l’ensemble des espèces diminuerait. Il est donc primordial de continuer les recherches en génétique d’autant que les variétés récentes sont les plus efficientes vis-à-vis de l’utilisation des ressources.
Avec ces orientations, il devient possible de concilier production et agroécologie.
Philippe Gate, membre de l’Académie d’agriculture de France
===
The Agricultural Water Varenne: an opportunity for sustainable agriculture
In May 2021, the Government launched the « Water and Climate Change Varenne ». This is a real opportunity because until now, national thinking has focused on agriculture’s contribution to mitigating climate change, particularly by reducing emissions. In the case of the « Varenne », it is a question of finding solutions to ensure the food function of French agriculture and to make it more resilient to climate change. The adaptation proposals must mobilise multidisciplinary skills to ensure the economic, environmental and societal performance of agriculture.
Indeed, agriculture is undergoing major changes. After the Second World War, production was in deficit and tools were put in place to ensure France’s food sovereignty. This path led to environmental drifts. Today, agriculture must go beyond its function as a source of food: to feed by demonstrating that it contributes significantly to the objectives of sustainability.
Anticipating climate change
At the global level, farmers are « condemned » to produce more to feed an increasingly populated world. And this is happening in a context where yields of many crops are stagnating due to the effects of climate change.
Moreover, climate change is a barrier to the implementation of agroecology. Agroecological practices are based on the diversification of species. As with the species that feed us, the implementation of these practices is also strongly subject to the effects of the climate, which are increasingly unfavourable and unpredictable (drought, excess water, excessive temperatures, or on the contrary frosty and late, too little radiation…)
Everything is moving very fast, and we need to anticipate how the mapping of species will evolve in order to identify adaptations in the territories.
Increasing water availability
Increasing the availability of water is the most effective lever because it guarantees the stability of production and allows the diversification of species. One solution would be to store part of the water that falls in excess for irrigation, knowing that the irrigation water returns to the atmosphere: imagine « eautonomous » farms. In addition, it is possible to recycle wastewater, which concerns about 0.6% of uses in France, compared with 8% in Italy, 14% in Spain and 80% in Israel.
Agroforestry, which consists of having trees cohabit with crops, is an avenue to be explored: the roots of the trees go down deep into the soil and act as a « hydraulic lift ». And also, like the establishment of permanent cover that covers the soil, agroforestry plays a role in regulating flooding.
Continued research into genetics
Without genetic progress, the yield of all species would decrease. It is therefore essential to continue genetic research, especially as recent varieties are the most efficient in terms of resource use.
With these orientations, it becomes possible to reconcile production and agro-ecology.
Philippe Gate, member of the French Academy of Agriculture
|