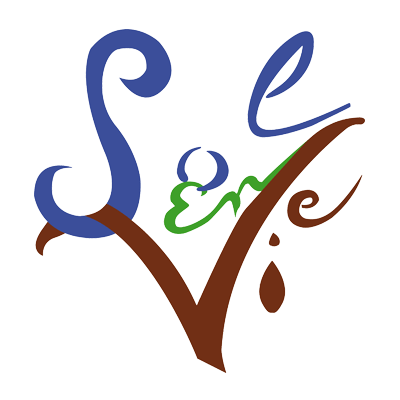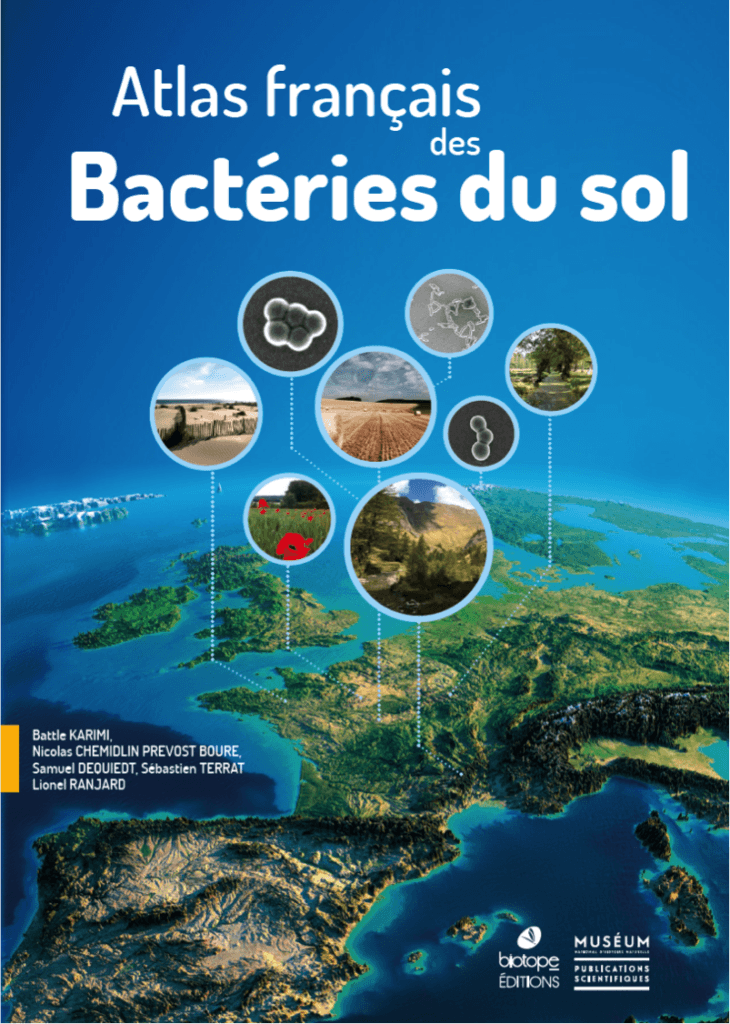Cycle de conférences « De la Terre, ses usages et ses récits »
Samedi 8 décembre, 17h00
HORAIRE ET LIEU A VÉRIFIER SUR CE SITE : Informations http://www.opera-mundi.org/
-
20/10/2018, FRAC PACA à Marseille – La propriété de la Terre- Sarah Vanuxem, juriste de l’environnement
Sarah Vanuxem apporte un éclairage renouvelé sur les principes de la propriété des choses et des personnes et les transformations que le droit émergeant de l’environnement apporte à la tradition juridique occidentale. Alors que la doctrine dominante conçoit la propriété comme « pouvoir souverain d’un individu sur les choses », Sarah Vanuxem montre qu’il est possible d’accorder des droits aux lieux. Considérant la propriété comme faculté d’habiter les choses mêmes et, en particulier, la Terre, la juriste invite à renouer avec la multitude des droits d’usage de la terre.
-
10/11/2018 à la médiathèque de Gardianne –> Le sol, un bien commun à protéger – Daniel Nahon, géochimiste
Les sols arables sont comptés. Seulement 22% d’entre eux sont capables de porter les cultures qui nous nourrissent. Mais par ignorance ils sont maltraités, pollués, érodés, urbanisés. Et déjà des millions d’hectares sont détruits chaque année. Que faire pour les protéger car la ressource n’est pas renouvelable à l’échelle humaine ? Quelles pratiques agricoles doit-on changer ? Comment le sol anthropisé joue-t-il sur le réchauffement climatique et comment en retour celui-ci modifie-t-il le fonctionnement de la terre arable ?
-
16/11/2018 à la bilbiothèque de Cabriès –> L’agroécologie pourra-t-elle nourrir le Monde ? Jacques Caplat, ingénieur agronome
Face à la crise agricole, il n’est plus pertinent d’opposer agriculture et environnement. À partir de son expérience de terrain et d’un retour historique, Jacques Caplat analyse la façon dont le « modèle » agricole actuel s’est élaboré puis fragilisé, et définit les bases d’une refondation de l’agronomie : semences paysannes, cultures associées, valorisation de la main-d’oeuvre, suppression des pesticides… Ces pratiques se révèlent non seulement très performantes à l’échelle mondiale, mais permettraient en outre de réconcilier enfin l’agriculture avec l’environnement, la société et les territoires.
-
08/12/2018 à la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille –> Dire le bon usage de la Terre, Une histoire du géopouvoir – Christophe Bonneuil, historien
Depuis un demi-millénaire, la définition des richesses, des équilibres et des limites de la Terre, de son « bon usage », durable et rationnel, est un enjeu de pouvoir. L’histoire environnementale nous rappelle que dès Christophe Colomb, les élites européennes ont forgé des discours et des savoirs sur le « bon usage » de la Terre. Ainsi, une théorie du changement climatique à grande échelle a participé à la légitimation du projet de prise de possession européenne de l’Amérique. Après avoir esquissé les enjeux d’une telle histoire, Christophe Bonneuil mettra l’accent sur l’ « âge des empires » de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
-
12/01/2019 à la FRAC PACA –> Terre de Paris.Vers un ancrage terrestre – Serge Joly et Paul-Emmanuel Loiret, architectes
En extrapolant les données actuelles, à l’horizon 2030, les volumes cumulés de terres inertes extraites en Ile-de-France seraient de l’ordre de 400 millions de tonnes. L’impact économique, estimé à plusieurs milliards d’euros, est aussi préoccupant que l’impact écologique. Dans le cadre de plusieurs projets de recherche appliquée, l’agence Joly&Loiret explore les possibilités pour recycler / réemployer une partie de ces « déchets » et en faire des matériaux de construction contemporains en terre crue pour le logement et plus largement la ville soutenable de demain. Cette démarche vise un rééquilibrage en faveur de la matière naturelle, face à l’artificialisation croissante de notre milieu de vie.
-
19/03/2019, à la médiathèque de Vitrolles –> Un nouvel ogre mondial : la mégalopole – Thierry Paquot, philosophe de l’urbain
À partir du court-métrage documentaire Faim de Terre réalisé en 2015 par Karine Music, Thierry Paquot analyse les mécanismes à l’oeuvre dans la redistribution du sol, son imperméabilisation, sa stérilisation, sa spéculation insensée. Prétexte pour réfléchir sur l’alimentation des villes et des campagnes à l’heure de l’anthropocène qui annonce, peut-être, l’urbanocène. Faim de Terre (32’) traite de l’artificialisation des terres agricoles en Provence et de ses effets sur l’homogénéisation des paysages, l’extinction programmée de certaines espèces végétales et animales et sur l’alimentation et la santé des êtres vivants, parmi lesquels les humains…
-
01/06/2019 à la bibliothèque de l’Alcazar de Marseille –> COSMOPOLITIQUES DE LA TERRE – PHILIPPE DESCOLA , ANTHROPOLOGUE
Dans bien des parties du monde l’usage d’un territoire est dépendant d’une foule de non-humains dotés d’une puissance d’agir autonome et avec lesquels les humains doivent composer – divinités, esprits, génies, ancêtres, montagnes, animaux, météores. Le rapport politique à la terre y diffère de celui qui nous est familier, soit parce que les non-humains sont des agents sociaux à l’intérieur d’un collectif englobant, soit parce qu’ils sont vus comme des sujets agissant dans leurs propres collectifs. Des exemples à méditer pour un traitement de la Terre moins destructeur et moins anthropocentré.
Dans le cadre du Cycle de conférences « De la Terre, ses usages et ses récits »
De la Terre, ses récits et ses usages nous invite à re-considérer cette notion de « terre » à toutes les échelles de notre environnement, selon une double approche symbolique et concrète. Dans le contexte de dégradation écologique et de sidération actuel, cette interrogation croisée sur les récits et les usages de la Terre cherche des voies pour penser et agir, en prenant soin de cette surface terrestre « sur » et « par » laquelle nous vivons.
Dire la Terre, c’est aussi dans un contexte de territorialité dire une terre que nous cultivons, qui nous nourrit, que nous dévorons, où nous cohabitons en complète interdépendance avec de nombreuses autres espèces. C’est revenir à cette seule terre, cette terre vivante et à l’examen de ce sol, artificialisé, anthropisé, afin d’en renouveler les usages.
Prenons le temps de penser ensemble aux récits et aux usages de la Terre qui nous ont menés jusqu’ici, en convoquant la diversité des disciplines et l’interconnexion des pratiques. Prenons le temps d’envisager demain, en compagnie de vingt-deux conférenciers – chercheurs, praticiens, savants, artistes… – tous penseurs et orateurs de talent.