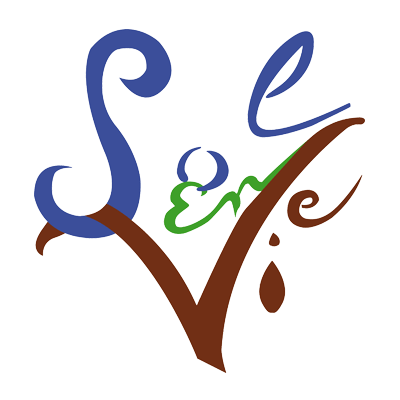« Le cépage est un instrument au service du terroir » annonce Michel Bettane, co-fondateur du célèbre guide des vins « Bettane & Desseauve ». Chaque terroir est unique, et influencé en grande partie par la nature de ses sols.
L’homme, conscient de cette singularité et respectueux de ce que la nature lui a offert, a toujours tâcher d’accorder à son terroir les cépages les plus adéquats. A l’inverse, la vigne, comme toute végétation, n’évolue pas de la même manière sur des types de sols différents.
[…]
Graves et Cabernet Sauvignon
Si le cabernet sauvignon est aujourd’hui planté dans le monde entier (Californie, Italie…), ce n’est pas un hasard si son expression la plus célèbre provient des vins du Médoc (Pauillac, Margaux…) et de l’appellation des Graves, plus au sud de Bordeaux. A l’origine de vins à la structure tannique affirmée, le cabernet sauvignon est un cépage tardif : il n’est pas connu pour être sensible aux maladies de la vigne et a un cycle de maturation assez lent (il est généralement vendangé en dernier à Bordeaux). Il a besoin de sols chauds et filtrants pour mûrir suffisamment et être récolté à temps. C’est la raison pour laquelle il affectionne les sols dits de graves de la rive gauche de Bordeaux (galets, graviers, sables), qui mutualisent cette capacité à filtrer l’eau et à garder la chaleur.
Argile et merlot
Le merlot est un cépage plus précoce que le cabernet sauvignon, son célèbre compère du vignoble bordelais. Il mûrit plus vite et peut donner des rendements beaucoup plus abondants. Il est donc possible de le planter sur des sols plus froids et plus humides. C’est ainsi que la rive droite bordelaise est en majorité plantée de merlot comme à Pomerol ou Saint-Emilion où les sols argileux, plus frais et plus riches, retiennent l’eau et optimisent la maturation relativement rapide des raisins.
Granites, schistes et syrah
La syrah, cépage emblématique de la Vallée du Rhône, est également très plantée dans le Languedoc. Ce cépage affectionne deux types de terroirs aux caractéristiques communes : les sols granitiques comme à Hermitage ou Saint-Joseph, et les sols de schistes comme à Faugères dans le Languedoc. Ces sols emmagasinent la chaleur et évacuent l’eau en excès ce qui limite le rendement de la syrah en la mettant en situation de stress hydrique : la vigne est en manque d’eau, ce qui concentre les raisins en sucre. En la privant de ressource hydrique, ces sols permettent à la syrah de produire des vins concentrés et très aromatiques.
Calcaire et chardonnay
Les sols calcaires de la Bourgogne et parfois crayeux de la Champagne marquent le terrain de prédilection du chardonnay. Ce cépage, à l’origine des plus grands vins de la région aime les caractéristiques de ce terroir qui lui permettent de garder son acidité. C’est dans ces sols calcaires que le chardonnay trouve des conditions de maturation lente, favorisant sa finesse aromatique. Sa fraîcheur décroit quand on passe de Chablis au nord, à Mâcon, plus au sud où il fait naître des vins plus ronds.
Lire l’article sur :
http://avis-vin.lefigaro.fr/wine-box-par-my-vitibox/o138022-couples-sols-cepages-les-grandes-histoires-damour