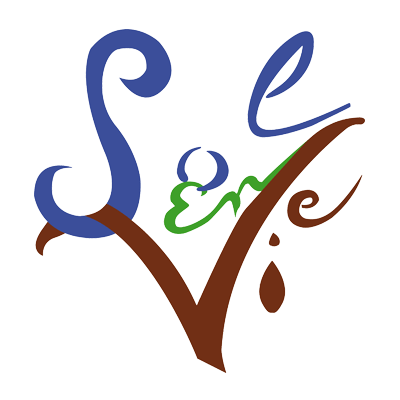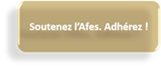Les terres nourricières sont soumises à la double pression de l’activité humaine et du changement climatique. Dégradation, désertification, insécurité alimentaire… Le GIEC en appelle à une gestion durable des sols.
Le GIEC a officiellement présenté le 8 août dernier son rapport spécial relatif au changement climatique et aux terres émergées. Cet examen, complet, porte précisément sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres.Nul doute que ce rapport contribuera à nourrir les réflexions lors de la COP 25 de la CCNUCC qui aura lieu en décembre à Santiago, au Chili.
Hommes, terres et climat dans un monde qui se réchauffe
L’activité humaine affecte directement plus de 70 % de la surface terrestre libre de glace de la planète. Et ce alors que la terre fournit la base principale des moyens de subsistance humaine, y compris l’approvisionnement en nourriture, en eau douce et en de multiples autres services des écosystèmes, ainsi que la biodiversité.
Depuis la période préindustrielle, la température de l’air à la surface de la terre a augmenté presque deux fois plus que la température moyenne mondiale. Les changements climatiques, y compris l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des extrêmes, ont eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire et les écosystèmes terrestres et ont contribué à la désertification et à la dégradation des terres dans de nombreuses régions.
Pour autant, les terres doivent rester productives pour maintenir la sécurité alimentaire en dépit de la croissance démographique et des effets néfastes du changement climatique sur la végétation qui ne cessent de croître. La marge de manœuvre est donc limitée pour tirer intelligemment parti des terres émergées afin de faire face.
Désertification, dégradations…
Le rapport prévient : la dégradation des terres résulte d’une chaîne complexe de causes rendant difficile la distinction claire entre les facteurs directs et indirects. Il liste toutefois de manière précise 44 processus de dégradation des terres et leurs liens avec le changement climatique.
Un sol dégradé est moins productif, car il est plus difficilement cultivable et perd de sa capacité à absorber le carbone. Et c’est un cercle vicieux puisque ce phénomène exacerbe le changement climatique, lequel exacerbe encore la dégradation des sols à de nombreux égards.
L’agriculture, la foresterie et d’autres types d’utilisation des terres représentent 23% de nos émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, les processus terrestres naturels absorbent une quantité de CO2 équivalant presque au tiers des émissions dues aux combustibles fossiles et à l’industrie.
Une gestion durable des terres, y compris la gestion durable des forêts, pourrait prévenir et réduire la dégradation des terres, maintenir la productivité des terres et parfois inverser les effets néfastes du changement climatique sur la dégradation des terres. Il faut entendre par « gestion durable des terres » l’intendance et l’utilisation des ressources terrestres, y compris les sols, l’eau, les animaux et les plantes, pour répondre aux besoins humains changeants, tout en assurant le potentiel productif à long terme de ces ressources et le maintien de leurs fonctions environnementales.Parmi les exemples d’options, on peut notamment citer l’agroécologie (y compris l’agroforesterie), les pratiques agricoles et forestières de conservation, la diversité des espèces végétales et forestières, les rotations appropriées des cultures et des forêts, l’agriculture biologique, la lutte intégrée contre les parasites, la conservation des pollinisateurs, la collecte des eaux de pluie, la gestion des parcours et pâturages, les systèmes agricoles de précision.
Ajoutons à cela qu’environ 500 millions de personnes vivent aujourd’hui dans des zones touchées par la désertification.Or, éviter, réduire et inverser la désertification permettrait d’améliorer la fertilité des sols, d’accroître le stockage du carbone dans les sols et la biomasse, tout en favorisant la productivité agricole et la sécurité alimentaire.
Prévenir la désertification plutôt que de tenter de restaurer les terres dégradées reste préférable, en raison des risques résiduels et des résultats inadaptés potentiels.
Des impacts en matière de sécurité alimentaire
Le rapport fait également ressortir que le changement climatique a une incidence sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire : la disponibilité (rendement et production), l’accès (prix et capacité d’obtenir de la nourriture), l’utilisation (nutrition et possibilité de cuisiner) et la stabilité (irrégularité de la disponibilité).
Des effets qui seront nettement plus accentués dans les pays à faible revenu d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes.
Pour les auteurs du rapport, des options d’intervention dans l’ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation, y compris les pertes et les déchets alimentaires, peuvent être déployées et mises à l’échelle pour favoriser l’adaptation et l’atténuation.
Certains choix alimentaires impactent moins les terres et la ressource en eau et causent moins d’émissions de gaz à effet de serre que d’autres. « Les régimes alimentaires équilibrés riches en aliments d’origine végétale tels que les céréales secondaires, les légumineuses, les fruits et les légumes, et les aliments d’origine animale produits de façon durable dans des systèmes à faibles émissions de gaz à effet de serre offrent de bonnes possibilités d’adaptation aux changements climatiques et de limitation de ces changements », selon Debra Roberts, coprésidente du Groupe de travail II du GIEC.
Il pourrait également être envisagé une diversification des cultures afin d’être plus résilient face aux variations climatiques.
Quelles politiques ?
Le GIEC livre plusieurs clefs au niveau des politiques à mener. Une mobilisation générale pour la durabilité, associée à des mesures immédiates, offrirait les meilleures chances de faire face au changement climatique. Parmi les conditions à remplir : une faible croissance démographique, une réduction des inégalités, une meilleure nutrition et une diminution du gaspillage alimentaire.
Des politiques climatiques et foncières qui se soutiennent mutuellement auraient le potentiel d’économiser les ressources, d’amplifier la résilience sociale, de soutenir la restauration écologique et de favoriser l’engagement et la collaboration entre de multiples intervenants Les politiques s’appliquant à l’ensemble du système alimentaire, y compris celles qui réduisent les pertes et les déchets alimentaires et influencent les choix alimentaires, permettraient une gestion plus durable de l’utilisation des sols, une sécurité alimentaire accrue et des trajectoires à faibles émissions.
L’efficacité de la prise de décision et de la gouvernance serait renforcée par la participation des parties prenantes locales (en particulier celles qui sont les plus vulnérables au changement climatique, notamment les populations autochtones et les communautés locales, les femmes, les pauvres et les marginalisés) au choix, à l’évaluation, à la mise en œuvre et au suivi des instruments politiques d’adaptation au changement climatique.
A lire sur :
https://environnement.actuel-hse.fr/